12/10/2018
Pierre Vinclair, Terre inculte, Penser dans l'illisible : The Waste Land (recension)
Il fallait une connaissance approfondie de la poésie française et anglaise, une pratique solide des deux langues et, aussi, être poète (1)pour s’engager, après Pierre Leyris, dans la traduction du poème de T. S. Eliot, The Waste Land, réputé "difficile" depuis sa publication en 1922(2), pour ne pas dire "illisible". C’est justement ce qui retient Pierre Vinclair : puisque ce texte apparaît illisible, il se demande ce que l’on peut en faire : « L’illisibilité n’est-elle qu’un défaut de lisibilité, ou peut-elle ouvrir à d’autres pratiques, dont le jeu formerait une autre lecture, une « illecture » ? Un texte peut-il ne pas être compréhensible, et produire pourtant du sens ? » Les réponses sont l’objet du livre, qui propose une traduction étroitement liée à une interprétation, et une "élucidation" (terme d’Eliot), soit la relation entre le texte et ses sources intertextuelles.
La dernière des huit parties réunit les traductions du poème d’Eliot, présentées par fragments dans le livre, les autres sont construites de manière à dégager à chaque fois une « posture critique ». Il est exclu de rendre compte de l’ensemble du livre, très dense, et qui invite pour une vraielecture à souvent laisser la page en cours et à relire des passages de tel ou tel ouvrage dans sa bibliothèque. Mais si exigeante soit-elle, la lecture n’est jamais lassante, portée par l’enthousiasme de l’auteur et sa rigueur : il n’avance rien — il ne traduit rien — sans apporter au lecteur les éléments qui lui font choisir telle ou telle solution.
Commençons par le titre. Eliot a publié The Waste Landavec des notes ; il a indiqué dans la première que ce titre, le plan et, en partie, le symbolisme du poème venaient du livre d’une universitaire anglaise sur la légende du Graal et il en recommandait la lecture. Le lecteur est d’emblée invité à passer du titre à un livre qui en est éloigné et, de là, à un texte du Moyen Âge : Pierre Vinclair relève à juste titre que rien n’interdit de continuer la recherche de renvois culturels et de les multiplier — ce qui peut être agréable (on lit ou relit des œuvres auxquelles on ne pensait pas) mais n’explique pas grand-chose ; la note signifie d’abord, même si cela n’épuise pas son contenu, qu’aucun texte ne part de rien. Une seule traduction conserve le lien au monde médiéval avec un mot disparu, "gaste"(3)(l’ancien français gasta, en allant au-delà du latin, la même origine que waste), pourWaste ; ce choix n’éclaircit rien. Pierre Leyris traduit par "vaine", cet adjectif ayant eu le sens de « vide, inculte » en parlant d’une terre (cf vaine pâture) ; plus explicite, Pierre Vinclair choisit "inculte" en commentant ce qui lui semble le propos du livre : « pour Eliot, la culture européenne est à l’agonie (elle est désormais stérile, comme une terre inculte). Le poème qui l’énonce (The Waste Land) en est à la fois le produit paradoxal (puisque cette terre est inculte) et l’assassin : il l’achève. » Achever la culture pour mieux la faire renaître implique la destruction de ce qui la constitue, d’où la présence, abondante, de références culturelles. « Mais comme des déchets ».
Ce qui est fait pour le titre, est poursuivi pour l’exergue (extrait de Pétrone) et pour la dédicace à Ezra Pound, dont on sait le rôle qu’il a joué dans la poésie du xxesiècle et pour Eliot lui-même : il a suggéré des suppressions importantes dans The Waste Land, suggestions suivies. Ensuite, question de méthode, Pierre Vinclair consacre plusieurs pages au premier vers (April is the cruellest month, breeding) ; son étude donne l’occasion d’écarter l’excès de références intertextuelles qui ne font pas avancer d’un pas dans la compréhension et s’il retient, ce qui a souvent été signalé, la relation entre ce vers et le premier vers du Prologuedes Canterbury Tales(Quand Avril de ses averses douces)(4), ce n’est pas pour se limiter à son existence mais pour se demander ce que fait Eliot quand il retourne le vers de Chaucer. Ensuite, il interprète cruellestpar rapport à breeding, « c’est la terre morte[vers 2 : Lilas out of the dead land, mixing) remuée, qui souffre des lilas qui se réveillent et s’élancent en elle » — explication qui reporte le lecteur à l’exergue. Enfin, il essaie plusieurs traductions (aucune n’est conservée) en avouant l’échec à restituer le rythme de l’anglais et le jeu phonique.
De l’analyse minutieuse du vers, des leçons sont tirées. Avant de traduire, il a fallu rendre compte des références, les interpréter ; ensuite vient une proposition à propos de ce qui s’engage avec ce premier vers — « Le poète est (…) du côté de la mort ». Enfin, ce travail a obligé à quitter le texte pour lire les commentaires, (re)lire Chaucer, consulter des dictionnaires ; pour résumer : ce que rappelle Pierre Vinclair par sa pratique, c’est qu’un texte ne peut être vraiment lu, a fortiori s’il doit être traduit, que si l’on prend la peine d’en sortir pour mieux y revenir.
La traduction de The Waste Land, soit 433 vers, est menée avec la même rigueur que celle du premier vers, avec la même vivacité aussi et, toujours, avec le souci de discuter des hypothèses, d’aider le lecteur à repérer ce qui ne peut l’être que par une fréquentation répétée du poème — ainsi est-il suggéré (« On s’en souvient… ») de revenir en arrière pour mettre en rapport des passages éloignés : par exemple, quand une allusion au troubadour Arnaud Daniel (dans la dédicace à Pound) est à nouveau présente au vers 427, elle est mentionnée : « [voir chapitre I, partie 2, p. 13].
L’intérêt de ce livre ne se limite pas du tout à la lente et informée "leçon de lecture" qu’est l’interprétation-la traduction. Ce qui arrête, c’est que certaines propositions de Pierre Vinclair concernant la poésie contemporaine rejoignent celles d’autres poètes. Ainsi, à l’issue du bref quatrième chant de The Waste Land, il conclut que « le poème apparaît comme un nœud de relations qui vont dans tous les sens (…) [et] fait souffrir son récepteur », et il ajoute sous forme de question : la tâche de la poésie aujourd’hui « n’est-elle pas de faire sentir la souffrance née de l’impossibilité de la synthèse du sens ? ». Question du sens que l’on retrouve dans les toutes dernières pages, mise en relation avec ce qu’écrivait Wittgenstein sur ce sujet à la même époque. Question du sens au centre de la réflexion d’un poète comme Christian Prigent : « la dimension de l’illisibilité est intrinsèque à ce type de rapport particulier à la langue et au réel qu’on appelle littérature » (Du sens et de l’absence de sens, dans "Silo", sur le site des éditions P.O.L). Que Pierre Vinclair explore la question en aboutissant à une traduction nouvelle d’un poème majeur accroît le plaisir de la lecture.
1.Pierre Vinclair a publié récemment un roman, La Fosse commune(2016), un essai, Le Chamane et les phénomènes. La poésie avec Ivar Ch’Vavar(2017) et un livre de poèmes, Le Cours des choses(2018). On lira des poèmes, des essais et des traductions de Pierre Vinclair sur le site Poésie : Traduction / Critique(vinclairpierre.wordpress.com). Par ailleurs, co-responsable de la revue en ligne Catastrophesil y publie régulièrement des traductions de poètes de langue anglaise de Singapour.
- La première traduction en français est de Pierre Leyris, en 1947 ; elle a été rééditée et fournit les notes de T. S. Eliot, écrites pour l’édition anglaise, et celles J. Hayward pour l’édition française.
- La Terre gaste, traduction de Michèle Pinson (1995).
- Traduction du Prologuepar Louis Cazamian donnée par Pierre Vinclair.
Pierre Vinclair, Terre inculte, Penser dans l’illisible :The Waste Land, Hermann, 2018, 204 p., 22 €. Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 18 septembre 2018.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre vinclair, terre inculte, penser dans l’illisible :the waste land, étude critique, illisibilité, t.s. eliot | ![]() Facebook |
Facebook |
03/06/2018
Pierre Vinclair, La honte de la nation
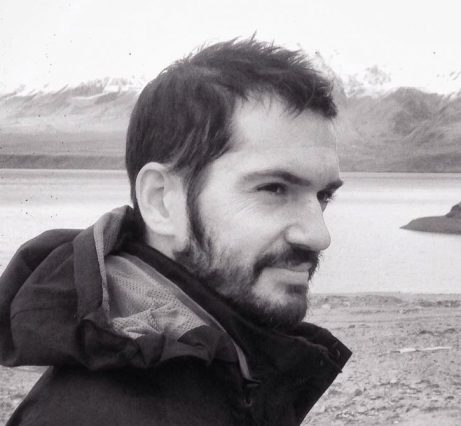
La honte de la nation
Il n’y a pas si longtemps, en France, on était poète de cour. Marot faisait mousser François Ier, Ronsard célébrait Henri II et Charles IX.
La tradition du poète officiel se perpétue d’ailleurs, dans bien des pays anglo-saxons, et (contrairement à ce que notre inconscient sans-culotte nous inciterait à penser) pas toujours au détriment du bon goût : William Wordsworth ou Ted Hughes en Angleterre, Elizabeth Bishop ou William Carlos Williams aux États-Unis, ne furent pas seulement des « poètes officiels ». Ils le furent aussi.
Il en va différemment en France : depuis le XIXème siècle c’est plutôt la figure du poète maudit (bohème, désargenté, mal reconnu, contestataire, et même geignard) que celle du poète lauréat à laquelle elle s’oppose, qui prévaut comme critère de valeur poétique. Le mirliton adolescent se rêve écorché vif, plutôt que tête poudrée et perruquée. Moi poète, se dit-il devant le miroir en soignant ses boutons d’acné, je serai Antonin Artaud. Et aujourd’hui, l’Académie Française pour compter des poètes dans ses rangs est obligée de faire appel à des plumes francophones venues de l’étranger : Dany Lafferière (Haiti, Canada), Michael Edwards (Royaume-Uni).
Exercice : Pensez à un poète français vivant dont vous admirez le travail, et imaginez-le dans l’habit vert. Avec la petite épée au côté droit.
On voit bien, ça ne marche pas du tout.
Vous me direz : il y eut Victor Hugo. C’est vrai, mais le poète de Jersey ne doit-il pas sa respectabilité poétique et morale à son opposition à Napoléon III, et à son exil ? Ses œuvres majeures — Les Châtiments, Les Misérables — sont celles d’un paria. De même, les effusions engagées de la seconde guerre mondiale : c’était d’abord une poésie de résistance. Non d’hymne patriotique. La poésie contre Vichy, au nom de la liberté, — pas de la France. La nation plus jamais ne fait bander du poète français la lyre.
Nation. Ça vient du latin natio qui désigne les petits d’une même portée. On le voit bien, c’est d’abord un objet métaphorique : sauf si tu es mon frère (peu de chances) ou mon cousin (salut Laurent), on n’est pas de la même portée, cher lecteur. Pourtant de la même nation, alors quoi ?
Une nation, dit le dictionnaire, c’est un peuple, constitué en communauté politique et partageant une langue. En refusant la nation, que croit contester le poète ? La langue ? La légitimité de l’État ?
Qu’il partage une langue avec d’autres, que celle-ci soit plus qu’un instrument mais une matière à reconfigurer, enrichir, déplacer ou lacérer, et même un milieu, le poète l’accorde en premier. Le cas échéant, il sait même se contenter de la grammaire et du vocabulaire des manuels. Il ne nie pas non plus l’existence de l’État, qui définit, par l’école, les programmes de quinze années d’initiation à la littérature, qui donne les bourses du CNL, qui encadre de lois publications et performances — et qui parfois est l’employeur du poète-enseignant, documentaliste, gendarme ou diplomate.
En refusant la nation, le poète français ne refuse donc ni la langue, ni l’État — mais plutôt : l’idée que l’une et l’autre se prédiquent d’une même entité, ou soient (comme qui dirait) deux modes d’existence de la même substance « France », par l’intermédiaire de laquelle elles communiqueraient, ou tout du moins, seraient en rapport. Et, partant, que les affaires de langue soient aussi une prérogative de l’État, puisque celui-ci est la volonté de l’entité dont celle-là serait la bouche.
Ce n’est pas tant que le poète, trop conscient de l’empreinte des logiques de pouvoir sur le discours, doive se donner pour mission de les saboter, couper la parole à l’État ou éventrer (avec l’aide du CNL quand même, si possible) ce rêve de congruence de la langue aux enjeux politiques — qu’exprime le concept de nation. Ni que la deuxième guerre mondiale continue, que Vichy guette, No pasaran ! j’écris ton nom.
Non : d’abord, c’est que la nation, ça n’existe pas. Il faut le dire. Il n’y a pas cette substance qui existerait derrière la langue et l’État : la nation n’est qu’un produit imaginaire du discours politique, elle est ce que l’État essaie de faire advenir par une certaine utilisation de la langue, décrets et mythes. Un État, avec son pouvoir bien réel (sa police, ses enseignants, ses diplomates) contrôlant un territoire donné sur lequel vivent diverses populations (elles-mêmes unifiées dans quelque objet imaginaire défendu par des institutions locales plus ou moins puissantes : famille, tribu, 9-3, Bretagne), appelle nation l’objet fantasmatiquement unique sur lequel s’applique son pouvoir. Quelle raison aurait le poète de chanter un objet aussi ridiculement hypothétique ? Et surtout : pourquoi accepterait-il d’identifier sa langue immense à un si pauvre petit territoire ?
Non seulement le poème est rétif à trop de hiérarchie, en effet (il se voudrait bien un lieu où le sens est l’enjeu et où la beauté se partage), mais cette utopie contredit la définition territoriale de la langue, qui est au cœur de l’idée de nation. D’ailleurs, ce n’est pas tant la langue qui est l’objet du poème, que la voix : y bat le projet, sans doute idiot, mais culotté (il faudrait voir comment ça peut marcher), que de la singularité de la voix puissent émerger des figures de sens à la fois immanentes et absolues. Pour le dire autrement : le poète parle, certes dans sa langue (mais une langue s’apprend et se traduit) à tous les hommes de la terre.
Voici la nation : une langue, un territoire. La France au français.
Voilà le poème : une voix, l’être, les hommes.
Pierre Vinclair, édito du n° 9 de Catastrophes, revue en ligne, 31 mai 2018 .
Le numéro 9 de Catastrophesest en ligne : https://revuecatastrophes.wordpress.com/la-honte-de-la-na...
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre vinclair, la honte de la nation | ![]() Facebook |
Facebook |
17/03/2018
Catastrophes, revue numérique de poésie

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, très peu de revues exclusivement, ou presque, consacrées à la publication de poèmes sont publiées sur internet, comme par exemple, ce qui reste. Catastrophes, depuis octobre, a fait ce pari : pas de notes de lecture, pas de commentaires, seulement un éditorial en accord avec le titre retenu pour chaque livraison : "Octobre 17", "Zombies ou fantômes", "Noël au ball-trap", "Hautes résolutions", "L’esprit du bas". Chaque fois, les textes sont regroupés en ensembles dont la désignation n’est pas faite, volontairement, pour orienter le lecteur, mais participe de l’esprit de la revue ; qu’on en juge : pour le premier numéro, "Boum", "Tilt", "Shebam", "Dring", "Wizzzz", pour le dernier, "fous", "lubriques", "cornards", "bateleurs". De plus, des poèmes publiés en feuilleton passent dans des rubriques différentes d’un mois à l’autre.
Pour l’esprit, il y a d’abord le titre, qu’on peut lire comme une provocation dans notre monde en crise — tout comme le logo de la revue (en tête de cet article) — ; mais "catastrophes" est au pluriel, et c’est un « pluriel optimiste » : pour paraphraser les responsables de la revue, l’écriture doit pouvoir bouleverser le cours des choses et créer en même temps, dans la voix, autre chose. Relisons la fin de l’éditorial de la première livraison, il y a à l’œuvre « un puissant désir de tout recommencer. (…) Comme si l’on reparlait, enfin, après la catastrophe. Comme si tout était à construire de nouveau. Comme si c’était Octobre 17. »
On pourra estimer le projet trop ambitieux, on peut aussi penser qu’il est nécessaire. Est bienvenue une revue de création qui « s’intéresse à toutes les voix », pour laquelle la poésie n’est pas exsangue, mais bien au contraire vivante, inventive, comme le prouvent l’abondance des éditions, la quantité de lectures publiques et de manifestations, le nombre de revues critiques sur internet — répétons avec Catastrophes qu’internet est un moyen qui facilite l’expérimentation. Dans toutes les directions : l’éditorial du n° 5, le dernier paru, souligne que « La poésie fait parler le corps de la langue, pas seulement la tête. Son corps qui jouit, mange, défèque, gonfle risiblement jusqu’à accoucher d’un renouvellement du temps. » Lisons encore une autre proposition, avec laquelle il serait difficile de ne pas être d’accord, pour dire ce qu’est le poème — de Nerval ou de Michaux, d’Emily Dickinson ou de Rose Ausländer : il « relève la part d’inconnu qu’il y a dans les choses », il est toujours du côté de « l’indécidable ».
Pour mener à bien ce projet, trois écrivains, Laurent Albarracin, Guillaume Condello et Pierre Vinclair travaillent ensemble, retiennent les textes et en sollicitent, choisissent les illustrations, toujours superbes (une pour chaque poème publié). Ils traduisent aussi : G. C., l’anglais, P. V., l’anglais, notamment celui de Singapour. Catastrophes est évidemment une revue ouverte à toutes les langues et, dans ces premiers numéros, le lecteur relira Gabriela Mistral (Chili), découvrira Leónidas Lamborghini (Argentine) et plusieurs poètes des États-Unis de la nouvelle génération (Leslie Harrison, Alan R. Shapiro, Muriel Rukeyser, Solmaz Sharif ). Mahomet, un essai d’Eliot Weinberger, écrivain d’une autre génération (né en 1949), n’était pas traduit, pas plus que Pound pour The Classic Anthology Defined by Confucius, dont la traduction par Auxeméry1 est accompagnée par celle de Pierre Vinclair du Shijing, anthologie de poésie chinoise d’avant notre ère. Auxeméry enrichit sa traduction d’une étude ("L’invention de la lumière ") sur la lecture du chinois par Pound, étude qui éclaire aussi la lecture que l’on peut faire des Cantos et, également, ce qu’est l’acte de traduire, « à la fois se ressembler et se rassembler. Devenir soi, le même de soi, dans le miroir, par l’entremise du miroir exigeant de l’autre en sa diversité. » Pierre Vinclair donne à lire des poètes de Singapour tout à fait inconnus en France (Christiane Cia, Madeleine Lee, Joshua Ip) et, en feuilleton, Claire Tching a entrepris de rassembler des poèmes souvent en français à Singapour ("La poésie française à Singapour"), le plus souvent par des inconnus.
Il faut reprendre l’ensemble des numéros parus pour voir en quoi Catastrophes, comme je l’ai noté, est une revue de découverte et de création. Outre la traduction de textes inédits en français, outre des poèmes des responsables de la revue, le lecteur rencontrera une "épopée papoue" en tercets de Florence Pazzottu et un poème en prose de Fabrice Caravaca, des sonnets (rimés) de Christian Prigent et un long poème — annoncé de 260 pages — signé Pierre Lenchepé2 et Ivar Ch’Vavar, Serge Airoldi et Alexander Dickow, les échanges de Julia Lepère et Fanny Garin, etc. Sans omettre une discussion entre Laurent Albarracin et Pierre Vinclair à propos de la haine de la poésie : à lire leurs livres, ils s’accordent sur le fait qu’on peut lire dans cette formulation de Bataille le fait que le poème « va dire enfin ce qui est, et qui ne peut être dit autrement » (P. Vinclair), que « la poésie mène du connu vers l’inconnu » (Bataille, Œuvres complètes, V, p. 158)
Catastrophes est mis en ligne chaque mois, mais il est bon de s’abonner : les contributions arriveront dans votre boîte avant d'être réunies : revuecatastrophes.wordpress@com
- Auxeméry a publié récemment un recueil de poèmes, Failles /traces (Flammarion, 2017).
- enchepé, en Picard, signifie « maladroit » — ce qui s’applique mal à Ivar Ch’Vavar…
Catastrophes, revue numérique de poésie, février 2018, n° 5, np.
Cette note de lecture a été publiée sur Sitaudis le 9 février 2018.
Publié dans RECENSIONS | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : catastrophes, revue numérique de poésie, pierre vinclair, laurent albarracin, guillaume condello | ![]() Facebook |
Facebook |
15/02/2018
Madeleine Lee, Arbres à pluie

Arbres à pluie
arbre à pluie immense
splendeur fière ancienne
bras haut levés vers les cieux
pieds fermement enracinés
toi, un sanctuaire
où les fougères nids-d’oiseaux offrent
des orchidées blanches sauvages — pour la paix
et la fougère cheveux-de-Vénus à tes pieds
se prosterne en remerciements
pour la promesse tenue
tes petites feuilles s’égarent
en travers de mon front
ouvrant mon troisième oeil
massant mon crâne comme le faisait mon père
il y a longtemps dans la mer méditerranée
on éleva une statue colossale
édifiante jusqu’à ce qu’elle tombe en miette sombrant dans les profondeurs de la mer
mais toi tu resteras debout
étant fait de matière des cieux.
Madeleine Lee, Arbres à pluie, traduction de l’anglais (Singapour) Pierre Vinclair, dans Catastrophes, revue numérique, n° 4, janvier 2018, "L’esprit du bas".
Publié dans ANTHOLOGIE SANS FRONTIÈRES | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : madeleine lee, arbres à pluie, pierre vinclair, sanctuaire, promesse | ![]() Facebook |
Facebook |





